Entre l’Amérique du Sud et la Polynésie s’étend le plus grand désert du monde, l’océan Pacifique. Au centre du Pacifique trône un vaste anticyclone. Il ne faut pas se fier à ces noms sympathiques, car ce sont deux géants pour lesquels l’homme est une poussière invisible. Le Pacifique est certes d’humeur moins changeante que la Méditerranée, mais ses colères sont aussi immenses que ses mensurations. Quant à l’anticyclone, imaginez une bulle de savon flottant dans les airs, comme celles que l’on voit dans certains spectacles de rue. Celle-ci est grande comme le Sahara, ses frontières sont floues et peuvent se déplacer de plusieurs centaines de miles en une journée. À l’intérieur, c’est le calme plat. La surface huileuse de la mer est parfois légèrement ridée par une imperceptible risée. Les voiles de votre bateau frémissent à peine puis retombent, épuisées de devoir porter leur propre poids. Magellan y perdit une grande partie de son équipage, mort de faim ou du scorbut après des mois à attendre le vent. Et malheur au navigateur d’aujourd’hui qui s’y retrouve pris, victime d’une panne de moteur ou n’ayant pas assez de carburant pour en sortir.
Vous l’avez compris, pour cette traversée, j’avais la ferme intention de me tenir à bonne distance des colères de l’un comme de la léthargie de l’autre. Partant du port de Valdivia, au Chili, je comptais rejoindre l’archipel des Gambier, en Polynésie française, distant de 3 300 miles. Les prévisions météo pour les quinze prochains jours m’incitaient à choisir un cap au nord nord-ouest jusqu’au-delà du 20eparallèle, puis d’abattre vers l’Ouest dès que je rencontrerais les alizés. Ensuite, il ne me resterait plus qu’à redescendre vers les Gambier, situés sur le 23eparallèle. Cette route passait très au nord de l’île de Pâques et rallongeait le parcours de 400 à 500 miles. À raison de 125 miles par jour, qui est une moyenne raisonnable pour un voilier comme le mien, il me faudrait trente jours pour effectuer cette traversée.
Je ne vais pas vous raconter ma navigation au jour le jour, comme c’est souvent le cas dans les récits de voyage. Mon journal de bord est aussi vide qu’un journal télévisé. Aucun événement notoire n’y figure, seulement le calcul de la distance quotidienne parcourue et la distance restant à parcourir. Le baromètre, le cap, la force et la direction du vent variaient si peu qu’il ne servait à rien de les consigner. Cette navigation fut un voyage intérieur dans cet océan souvent inexploré, et semble-t-il infini, que l’on appelle l’âme. Un mois sans voir personne, rêvais-je… Jésus avait tenu quarante jours dans le désert, mais n’est pas Jésus qui veut.
J’appareillai de Valdivia au début d’un bel après-midi de printemps austral. Un vent du sud de 20 à 25 nœuds était prévu pour les quatre prochains jours, ce qui me permettrait de remonter rapidement vers le nord et, ainsi, de quitter la zone dépressionnaire. De fait, aidé en cela par le courant de Humboldt, qui remonte le long des côtes chiliennes, mon fier navire parcourait 160 miles par jour au grand largue, la meilleure allure qui soit.
Vers la fin du troisième jour, je doublai les îles Juan Fernandez, plus connues sous le nom d’îles de Robinson Crusoé – pauvre Juan Fernandez ! –, car c’est sur l’une d’elles qu’Alexander Selkirk, le héros qui inspira Daniel Defoe, fit naufrage. Passé ces îles, dernières terres visibles avant la Polynésie, le vent tomba progressivement. De 20 nœuds il passa à 15, puis à 10, puis oscilla entre 5 et 10 nœuds durant les trois semaines qui suivirent. Je me trouvais probablement en bordure de l’anticyclone, dans cette zone hasardeuse où le vent semble toujours hésitant.
5 à 10 nœuds en vent arrière, tous les marins vous le diront, c’est épuisant nerveusement. J’avais hissé toutes les voiles pour profiter du moindre souffle d’air. La mer était calme, mais malheureusement pas plate. Le plus léger roulis provoquait un claquement des lattes de la grande voile qui secouait le gréement comme un cocotier. À l’avant, le génois pendait mollement sur son tangon, tandis que, sur l’autre bord, le spi libre effectuait une danse dont la chorégraphie m’échappait totalement. La moindre vaguelette faisait rouler le bateau bord sur bord en prenant soin de déclencher une oscillation dans le seul but d’éprouver mes nerfs et mon sommeil. Les quelques oiseaux de mer que je croisais semblaient sommeiller sur l’eau et ne prenaient même pas la peine de s’envoler à mon passage. Une immense torpeur régnait sur l’Océan.
Que la mer est belle quand elle est formée par un vent de 20 à 30 nœuds ! Une ample houle se creuse, sur laquelle dansent des moutons bien blancs. Des nuages, également blancs, courent dans le ciel, tandis que mon voilier bondit de vague en vague sous ses voiles d’une blancheur éclatante. Plongé dans une telle pureté, le navigateur devient acteur et spectateur d’un opéra féerique. Si le vent forcit, l’opéra devient terrifiant – beau et terrifiant à la fois. Mais si le vent tombe, il n’y a plus d’opéra. Il faut alors s’occuper autrement.
Je remarquais chaque jour de petits changements s’opérer dans mon esprit. Je me passionnais – enfin ! diront certains – pour les tâches domestiques. Dès le matin, je me demandais ce que j’allais préparer à déjeuner. J’inspectais mon frigo et l’état de mes vivres frais. Afin de combler le manque absolu de stimulation extérieure, je notais les mille petites choses du bord que je me promettais de faire le lendemain : réparer la fuite de l’annexe, recoudre le bord de fuite du génois, refaire le vernis dans le carré….
Je repensai à mes grands-parents, quand je les voyais, après la vaisselle du petit-déjeuner, noter cérémonieusement la liste des courses à faire. À 10 h 30, ils partaient au Monoprix, situé à un quart d’heure de marche de la maison. Dans les rayons du supermarché, ils accomplissaient leur immuable parcours et cochaient au fur et à mesure les articles sur leur liste. À 11 h 30, de retour à la maison, ils préparaient le déjeuner. À 13 heures, la sieste, à 15 heures, la lecture du journal, les mots croisés et quelques parties de cartes. À 20 heures, après un dîner léger, ils s’installaient devant le sacro-saint journal télévisé. À 22 heures, ils éteignaient la télé, cette grande endormeuse, et allaient se coucher. Le dimanche, le Monoprix étant fermé, ils tentaient une expédition plus lointaine. Cette routine, destinée à tromper le temps, était comme une petite mort qui les préparait au grand saut dans l’éternité.
Pendant cette traversée, mon univers s’était réduit aux 12 mètres de mon bateau, sur lequel j’étais totalement privé de distraction. En effet, après avoir dévoré un livre par jour durant la première semaine, je n’arrivais même plus à lire un San Antonio. Quant aux films – ma filmothèque de bord se limitant à quelques-uns de mes films préférés –, je les avais déjà tous vus un nombre incalculable de fois.
Je savourais certes le bonheur, en cette période de fêtes de fin d’année, de ne pas être envahi par la sollicitude de mes contemporains. J’étais d’ailleurs convaincu que Jésus lui-même aurait eu en horreur cette foire aux cadeaux de Noël. Néanmoins, passer des journées sans rien faire, sans distraction et sans aucune interaction avec le reste de l’humanité constitue une épreuve surhumaine. Une épreuve, soit dit en passant, que la plupart d’entre nous parviennent à repousser jusqu’aux derniers moments de leur vie.
« Quelle chance j’ai de connaître cette sensation avant d’être tout à fait vieux ! » me dis-je. Car derrière cette petite mort se révèlent bien souvent les plus grands mystères de la vie.
Je franchis une nouvelle étape en me détachant des petites préoccupations de la vie à bord. Je confiai à mon instinct de survie la mission de gérer l’intendance. J’entamai une sorte de jeûne, ne grignotant plus que de temps en temps ce qui me tombait sous la main. Le vide le plus absolu s’installa dans mon esprit. Seul sur l’Océan, loin de la trépidante humanité, j’étais prêt pour une réunion au sommet avec Jésus, Bouddha ou Mahomet. J’appelai Jésus, que je connaissais mieux :
— Jésus, lui dis-je, l’humanité est mal barrée. Elle doit avoir totalement perdu le cap pour saccager ainsi le plus beau joyau de l’univers. Les hommes ont besoin qu’un prophète vienne les guider comme tu le fis il y a deux mille ans.
— En vérité, mon frère, je te le dis, me répondit-il comme à son habitude, cette mission n’est pas sans risque, dont le moindre n’est pas celui d’être compris de travers ! À tel point que je me demande aujourd’hui si je ne suis pas un peu responsable de la situation actuelle.
— En quoi ? fis-je, vivement intéressé par ses états d’âme.
— Eh bien, si mes paroles étaient justes, et elles ne pouvaient que l’être car c’était la Parole de Dieu, ma présence parmi les hommes fut une erreur.
— Pourquoi diable !? m’exclamai-je.
— Parce que les hommes, voyant le fils de Dieu se sacrifier pour eux, crurent qu’ils étaient la créature préférée de Dieu et que l’Univers avait été créé pour eux.
— Et ce n’est pas le cas ?
— Dieu ne fait pas de différence entre un brin d’herbe et votre miss Univers. Peu lui importe que l’homme mange le poisson ou que le poisson mange l’homme.
— Qu’est-ce qui lui importe alors ?
— Tout ce qui existe, l’homme y compris, me dit-il en soupirant, visiblement lassé de devoir répéter une telle évidence à d’éternels cancres. Ne le trouves-tu pas sublime, féerique, riche, plein d’intelligence et d’émotion ?
— Évidemment ! lui répondis-je, sinon je ne serais pas là à voguer sur l’Océan, mais resterais plutôt devant ma télé.
— Eh bien, c’est cette Beauté qui lui importe. Au-delà du Bien et du Mal, il y a le Beau et le Moche. Oh ! Esprit désespérément rationnel, ne crois-tu pas que seule cette quête du Beau peut expliquer la splendeur de la Création ? D’ailleurs, ton bonheur et ton malheur en dépendent directement. Quand tu fais un truc moche, la punition tombe immédiatement, sans attendre le jugement dernier. Alors que l’on peut faire le Mal sans même s’en rendre compte de son vivant.
— Je connais bien des gens, entrepreneurs, artistes, urbanistes, qui font des trucs très moches et s’en trouvent très satisfaits !
— Trouver une chose belle n’est pas le bonheur. Cela s’appelle le contentement. Le bonheur, c’est de te sentir beau. Voilà pourquoi, s’il t’est agréable de t’extasier devant la beauté de la Création, il est fabuleux de sentir que la Création, elle aussi, te trouve beau.
Voulant recentrer le débat sur des préoccupations plus terre à terre, j’en revins au problème qui me rongeait :
— Sans même parler de beauté ou de bonheur, l’homme a aujourd’hui conscience qu’il doit protéger la nature. Mais il n’y parvient pas.
— Il n’y a pas d’un côté la nature et de l’autre l’homme. L’homme – aussi sapiens soit-il, dit-il avec une moue moqueuse – fait partie de la nature. Voilà pourquoi protéger la nature contre les hommes n’est pas une solution heureuse, ni pour l’homme ni pour le Créateur. C’est donc impossible.
— Que faire alors ?! demandai-je, un peu désespéré. Je ne suis pas venu jusqu’au milieu de ce désert Pacifique pour pêcher quelques belles paroles !
— Avant de faire quoi que ce soit, assure-toi que sous tous les angles où tu pourras l’observer, de ta jeunesse à ta vieillesse, voire au-delà, ta création sera belle. Tu es sans doute trop jeune pour y avoir prêté attention, mais je me souviens qu’il y a deux mille ans, les hommes ne s’extasiaient pas comme aujourd’hui sur la beauté de la nature. C’est parce que ce qu’ils ont fait ces derniers temps est tellement moche en comparaison ! Il n’y a rien de plus regrettable pour l’homme que de consacrer sa vie à une création qui lui paraissait belle au début et qui ne l’est plus quelque temps après. Vous devez être bien malheureux !
— Comment, selon toi, retrouver ce sens du beau ? le questionnai-je, toujours en recherche de solutions pragmatiques.
— Tu es né avec, continua-t-il. Vois la beauté du cœur d’un enfant. Puis, vous perdez ce sens du beau parce que votre éducation parvient à l’étouffer.
— C’est juste une question d’éducation ?!
— Te souviens-tu du barbare que tu étais à la fin de tes études ? me dit-il en m’adressant un clin d’œil amical. Il t’aura fallu trente ans passés à parcourir le monde pour enfin t’ouvrir à la Beauté.
Je souris à ce souvenir et compris enfin pourquoi j’avais eu l’école en horreur, pensai-je à part moi, tandis qu’il reprenait :
— L’école vous apprend les sciences et les techniques. La science est belle, comme l’est toute forme d’intelligence, mais elle ne doit pas supplanter votre sensibilité naturelle au beau. Il faut parvenir à approfondir l’une tout en entretenant l’autre. C’est en perdant le sens du beau qui, au même titre que les autres sens, participe à votre présence au monde, que vous avez perdu l’un de vos plus élémentaires instincts de survie.
Je griffonnai ses paroles à la va-vite afin de ne pas en perdre une miette, tout en réfléchissant à ma prochaine question. Mais ce fut au moment même où je pensais avoir saisi l’essentiel du message qu’il me quitta.
Peu après son départ, j’entendis, venant du ciel, un air d’opéra. Le vent gonfla les voiles de mon bateau comme il gonfla mon cœur. La mer se forma et une merveilleuse sensation de vitesse enivra mes sens.
Après des semaines de calme durant lesquelles mon bateau parcourait péniblement 70 miles en 24 heures, la vie, cette tension permanente vers l’avant, reprenait. Un rythme s’installait, un objectif se dessinait. Une semaine plus tard, à une moyenne de 150 miles par jour, j’atteignis l’archipel des Gambier. Je pénétrai religieusement dans son lagon aux eaux turquoise, glissai entre ses îles couvertes de végétation luxuriante. Derrière les frondaisons, on apercevait les tours colorées d’une église. Un silence religieux régnait.
Je jetai l’ancre dans la baie de Mangaréva, devant la petite bourgade de Rikitéa. L’eau était chaude et translucide, des enfants s’amusaient à sauter du quai dans de grands éclats de rire, l’air était doux, la terre sentait bon.
Je me rendis à pied au poste de gendarmerie pour remplir les formalités d’entrée. Les habitants me saluèrent sur mon passage d’un chaleureux « Bonjour » et m’offrirent des fruits. Les gendarmes, équipés de shorts et de tongs, m’accueillirent d’un « Bienvenue en Polynésie! » puis m’invitèrent dans leur cahute et me donnèrent tous les renseignements que je désirais.
Bon Dieu ! Jésus, priai-je… Comment fait-on pour redescendre sur terre ?!







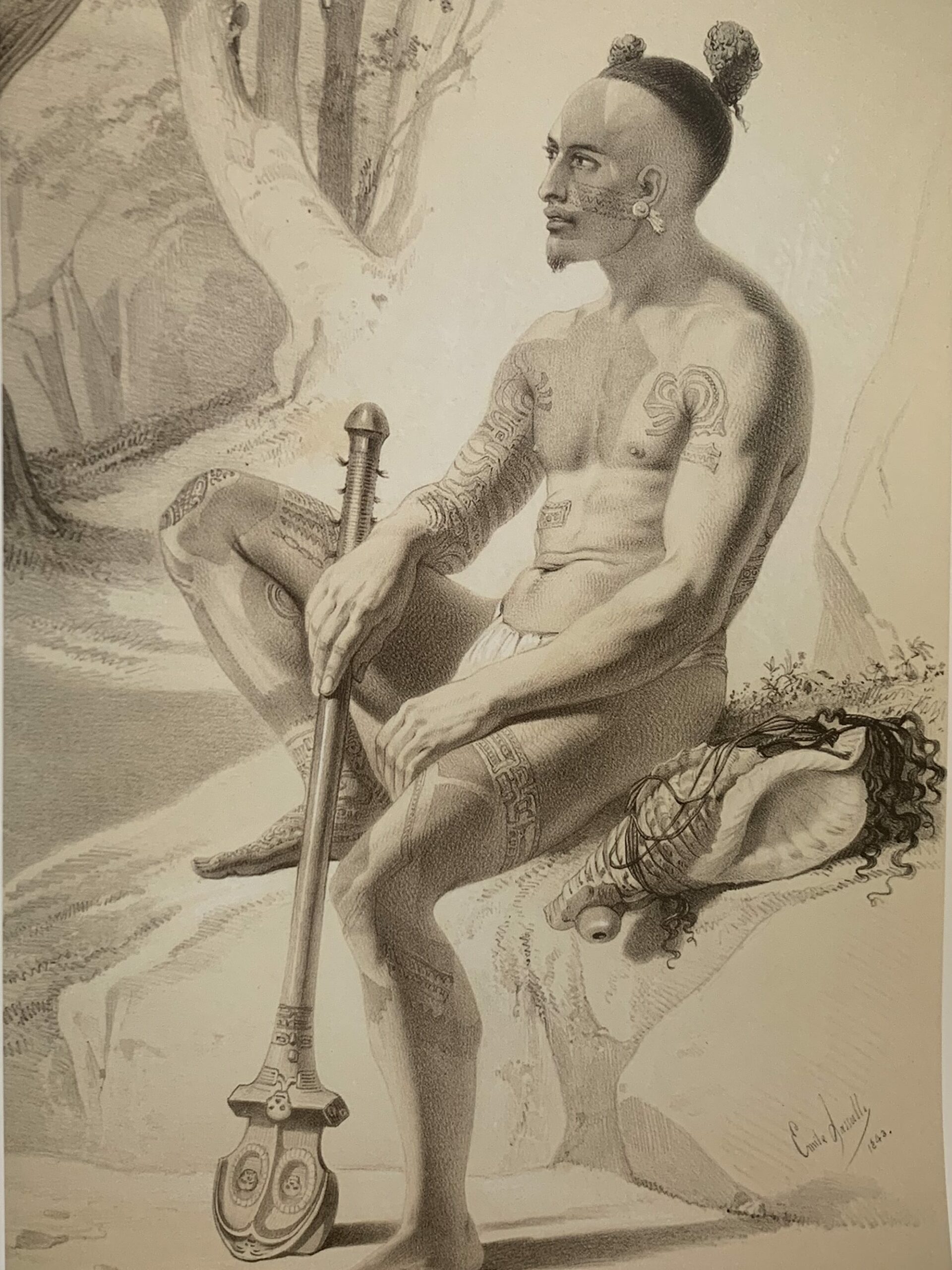
Merci de ce merveilleux moment de lecture , c est très agréable de savoir qu ily a d autres pêcheurs de rêves encore en mer
Bonjour, je crois que nous nous sommes coupés de la nature qui est devenue un loisir voire une carte postale. Bref, elle nous rend service, fait plaisir aux yeux, à l’odorat, au toucher, mais elle est déshumanisée. Et c’est pour cela que nous acceptons si facilement sa lente agonie tant qu’elle remplit son rôle même a minima; De même, nous mangeons avec cette « légèreté insoutenable » qui nous caractérise de la viande d’animaux qui passent leur existence à souffrir pour le plaisir de nos papilles ou pour une nécessité protéinée fumeuse. Je pense que nous irons jusqu’au bout de l’extinction de la source de nos besoins artificiels ou inutiles sans se soucier de notre avancée vers le bord du précipice, et cela ne m’émeut pas. Bien à toi où que tu sois.